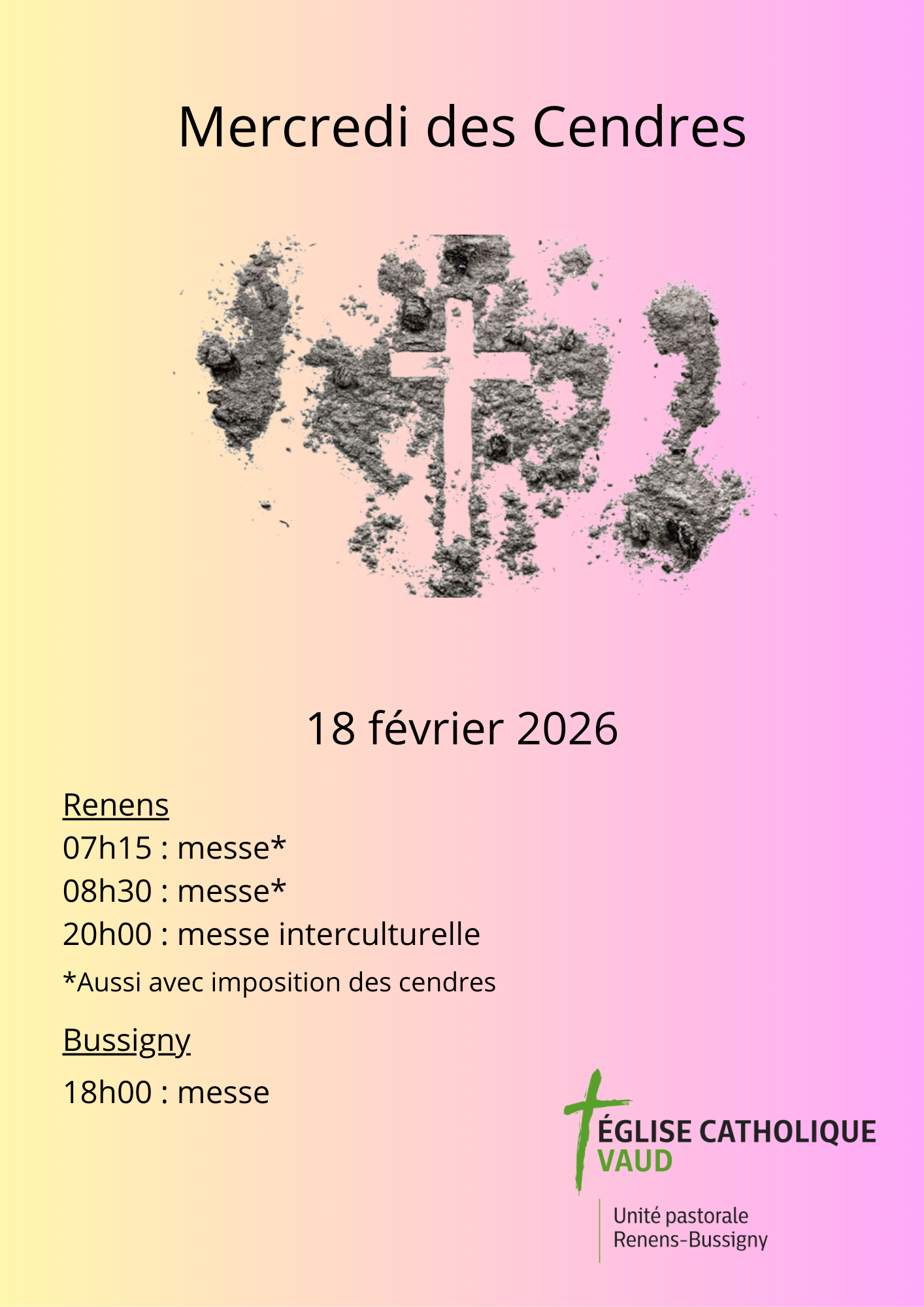La basilique Notre-Dame de l’Assomption à Lausanne était pleine dimanche 7 septembre pour la messe pontificale marquant son inauguration après vingt ans de travaux. Célébrée par l’évêque, Mgr Charles Morerod, qui a ouvert les portes et consacré le nouvel autel, elle a été l’occasion de rendre grâce pour un patrimoine culturel et religieux unique et de remercier les institutions publiques, les donateurs et les acteurs qui ont permis cette restauration.
Ambiance festive à la basilique Notre-Dame du Valentin ce dimanche 7 septembre pour son ouverture officielle au public après vingt ans de travaux ! C’est dans un bâtiment qui avait retrouvé tout son éclat que paroissiens et autorités se sont retrouvés pour une messe pontificale célébrée par l’évêque, Mgr Charles Morerod, entouré d’une quinzaine de prêtres et de diacres. Cette messe, action de grâce pour clore les travaux de la basilique et inaugurer le nouveau mobilier liturgique, était célébrée de manière anticipée pour la Nativité de la Vierge Marie, souveraine de Lausanne et patronne du diocèse – fêtée le 8 septembre.
Les fidèles présents ont pu entendre en création la «Missa solemnis et Magnificat pour choeur, orchestre et orgue», messe solennelle composée par Maixent Pilloud et interprétée par le Chœur de la basilique.
Deux temps forts
Deux temps forts ont marqué cette célébration: l’ouverture des portes et la consécration de l’autel. Devant les fidèles réunis sur le parvis, l’évêque a frappé les portes de la basilique de sa crosse, puis elles ont été ouvertes par le curé et deux paroissiens et tous sont entrés en procession derrière l’évêque, les servants de messe, les prêtres et les diacres. Puis l’évêque a béni le sel et l’eau qui a servi au rite de l’aspersion du bâtiment et de l’assemblée – pour les purifier.
Le nouvel autel a été consacré par Mgr Morerod après la liturgie de la Parole. Le rite a commencé par la litanie des saints, de Marie en particulier, patronne de la basilique, signe de la communion avec l’Eglise du ciel, et la déposition des reliques dans l’autel – des apôtres et martyrs Pierre et Barnabé, de saint Jucundinus, de saint Simplicien, martyr, de sainte Irène, vierge et martyre, et de sainte Modestine, martyre. Puis l’évêque, ayant revêtu un tablier, a procédé à l’onction de l’autel avec le saint chrême, faisant de lui le symbole du Christ. Enfin, il l’a encensé en signe de dévotion et d’action de grâce du peuple de Dieu. Les nappes posées ensuite sur l’autel ont manifesté qu’il est la table eucharistique.
Dans son homélie, Mgr Morerod a relevé que «Dieu agit avec nous de manière très humaine»: «Lui qui n’a pas besoin d’un bâtiment pour être avec son peuple, il a accepté qu’on lui construise un temple à Jérusalem parce que le peuple réclamait ce signe». Commentant l’évangile – la généalogie du Christ –, il a relevé combien «elle nous rappelle que l’Eglise corps du Christ et temple de l’Esprit, c’est nous». Il a enfin appelé chacun à «respecter ce bâtiment béni et honoré par le Seigneur. Mais si nous voulons que ce temple soit le signe de la Bonne Nouvelle, il nous faut nous respecter nous-mêmes et respecter les personnes, car nous sommes le temple de l’Esprit».
Vingt ans de travaux
Cette messe marquait l’aboutissement de vingt ans de travaux, une authentique aventure humaine et patrimoniale menée sous la direction de l’architecte Christophe Amsler. Des travaux réalisés en trois étapes suite à la chute d’une partie du clocher sur la chaussée: en 2005 et 2006, la restauration du clocher; en 2011 et 2012, la rénovation de la toiture et de l’enveloppe extérieure; de 2021 à 2025, la rénovation de l’intérieur: restauration de la fresque monumentale du chœur, œuvre du peintre italien Gino Severini en 1934, nettoyage et restauration de 29 vitraux signés Alexandre Cingria, Paul Monnier et Pierre Estoppey, rénovation du narthex et relevage de l’orgue historique. Un nouveau mobilier liturgique intégrant des éléments de l’ancien a également été installé. Les travaux ont mis au jour un dallage ancien, des niches et une frise peinte datant du 19e siècle. Ils ont mobilisé 32 corps de métier.
Cette restauration vise à créer un dialogue harmonieux entre les différentes époques de la basilique, de style néoclassique, construite par l’architecte Henri Perregaux entre 1832 et 1835 et classée monument historique. Première église catholique bâtie à Lausanne après la Réforme, en 1536, Notre-Dame a été promue au rang de basilique mineure par Jean Paul II en 1992.
De généreux donateurs
Si la basilique du Valentin est aujourd’hui flambant neuve, c’est grâce à divers donateurs institutionnels et privés qui ont réuni 9,2 millions de francs sur un coût total de 10'860’000 francs. La Ville de Lausanne, le Canton de Vaud et la Confédération ont financé 27% de cette somme, des fondations privées 65% et des donateurs privés 8%.
Ainsi restauré, le lieu central de célébration de la communauté catholique du Grand Lausanne pourra continuer à accueillir les fidèles pour des temps de silence, de prière et de célébration avec 22 messes hebdomadaires, 4 prêtres, 6 communautés linguistiques et 300 bénévoles.
Pour l’abbé Jean-Marie Cettou, recteur de la basilique et curé modérateur de la paroisse Notre-Dame, le sanctuaire restauré est, «au centre de la ville, un écrin de paix». Il a souligné que «la basilique Notre-Dame méritait de retrouver sa magnificence originelle. Les efforts déployés pour ces travaux de restauration n’auront pas été vains: désormais, chacun peut percevoir en elle un hymne à la Beauté».
Un diaporama retraçant les vingt ans du chantier, réalisé par le photographe Rémy Gindroz, est visible dans le narthex. Enfin, en collaboration avec la Société suisse d’histoire de l’art, la paroisse Notre-Dame a édité un guide de 80 pages richement illustré qui situe la basilique dans son contexte historique, spirituel et architectural.
GdSC
Crédit photo : Rémy Gindroz